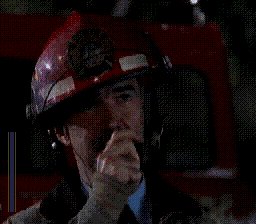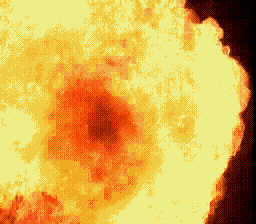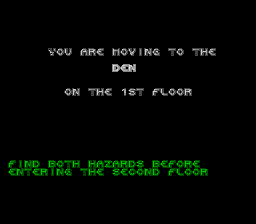Le site qui connait le nom de famille de Jules-de-chez-Smith-en-face.
Fahrenheit

On va pas pleurer, c'est moi qui vous le dis
Si je devais piocher un grief, un seul, dans l'éventail que j'ai à l'encontre du secteur vidéo-ludique actuel, c'est sa triste linéarité qui le rend aussi prévisible que la prochaine mise en examen de Patrick Balkany. Depuis une quinzaine d'années, les grands timoniers du marché font ronronner leurs machines sur des rails confortables, se risquant tout au plus à manier quelques postes d'aiguillage de temps à autre, histoire de montrer que l'on sait troquer ses charentaises douillettes contre des mocassins au cuir un peu jeune. Si je devais me risquer à la vulgarité, je qualifierais ceci de comportement de peine-à-jouir, voire d'électeur de centre-droit. Mais restons courtois. Pour le moment.
Ah ça, il commence à être loin le temps où l'offre était pléthorique, fourmillante, chaotique ; où l'on pouvait par exemple déballer avidement un CD-I au pied du sapin parce que l'on prophétisait l'avenir du jeu vidéo dans les reflets irisés des disques de la machine de Philips. On s'en tient encore les côtes.
Le Mega CD fait partie de cette génération aux relents soufrés. Un emblème, un fanal. Une console du bois dont on fait les cales de porte. Une performance technologique qui n'a longtemps été qu'un fantasme prudemment caressé par une génération de joueurs et qui a finalement permis d'accéder à notre désir ludique longtemps relégué dans un coin sombre de notre conscience, souvent inavoué, à peine murmuré du bout des lèvres : des vidéos en 16 couleurs et disposées en 128x112 pixels. Un bruit, un mot commence alors à circuler à cette époque et semble répondre à ce fantasme : le Full Motion Vidéo. Full Motion Vidéo que l'on traduira par Plein Mouvement Vidéo. Francisation oblige, le jeu étant sorti en pleine période où sévissait la loi Toubon sur le bon parler francophone et la normalisation des crânes lisses. Restons prudents, des francopathes dogmatiques rôdent encore. En tout état de cause, ce FMV/PMV constituait pour tout vidéo-joueur du début des années 90 un accès vers l'ultime frontière interactive sur un modeste téléviseur de salon Radiola. Merci monsieur SEGA.
Les bons titres Mega CD, on les compte sur les doigts de la main, à quelques phalanges près. Si l'on exclut toutes les vilaines choses à base de Plein Mouvement Vidéo ce qui écrème déjà 75 % de la ludothèque et que l'on purge les titres Mega Drive artificiellement dopés à la bande-son CD, on arrive à un décompte relativement maigre. On frise même lanémie. Que reste-t-il ? Quelques bons jeux. Dont il ne sera pas question ici. Oui. C'est une escroquerie. Alors de quoi va-t-on causer foutrediable ? De Fahrenheit. Ça vous la coupe, hein ? Non ? Bon. Baste, parlons-en tout de même.
Fahrenheit. Quel est cet étrange objet ? Un jeu en Plein Mouvement Vidéo (sic) comme on nous en offrait par tombereaux entiers durant la première décennie 1990. Avec des gens qui brûlent. Que voilà une promesse affriolante.
Cette promesse, c'est la même que celle faite par la ribambelle de titres à laquelle appartient Fahrenheit (cf. un poil plus haut, si si regardez bien), majoritaire pour la machine. Avec le même résultat. Mais chut chut, ne brûlons pas les étapes. Ce calembour ne vous sera pas facturé.
Carlito est là, on peut commencer la fiesta
Alors, que s'engage à m'offrir ce jeu ? La vie, la vraie, comme dirait une chaîne de grandes surfaces qui uvre pour l'épanouissement personnel et les contrats de travail pérennes et lucratifs. Et plus précisément ce fameux Plein Mouvement Vidéo susmentionné (si si regardez donc, foutredieu) et ses capacités à immerger le joueur dans un flot de sensations réalistes à un point que cela en deviendrait presque dérangeant et contre-nature. Pensez donc, on a mis des vrais gens avec des vrais images dans la galette, alors hein, si ce n'est pas la réalité vraie qui vient vous empoigner par les deux oreilles de ses mains puissantes, c'est que vous êtes neurasthénique ou homéopathe.
Vous enfilez donc ici la défroque de combattants du feu sans peur, sans reproches et sans couverture maladie totalement efficace (nous sommes aux USA, précisons-le). Combattants du feu, des chatons coincés dans les arbres, de personnes âgées alcooliques et démentes ainsi que dindividus morts sur leurs toilettes depuis 3 semaines - il est toujours bon de rappeler les détails de cette noble profession. Quoiquil sera ici surtout question de barbecues tragiques dans des pavillons de banlieue, de coups de grisou scélérats dans des cages d'escaliers sentant l'urine, de combustions spontanées et de résidus carbonés sur une moquette d'hôtel. Mise en scène grandiloquente oblige.
Pour vous donner du coeur à l'ouvrage mes petits loups, je vais vous chanter un air du pays
La tâche de nos gros canaris amiantés est simple : se glisser dans des bâtiments aussi frais que le cul de Lucifer, repérer et sécuriser tout objet susceptible de vous sauter à la gueule et trouver des gens, vivants et modérément cuits dans la mesure du possible. Le tout sans abîmer les beaux uniformes fournis par la municipalité. Trouver des gens. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Faisons-même une pause déjeuner car il s'agit probablement de la clef de voûte de ce jeu. Celle faite en plâtre bon marché et susceptible de faire écrouler tout l'édifice à la moindre vibration ou flatulence incontrôlée. Car qui dit trouver dit chercher. Et qui dit chercher dit être en possession de putains déléments tangibles pour se diriger dans cette espèce de barbecue géant. Éléments que l'on a méthodiquement siphonnés de l'intégralité du disque. On est pas sortis de lauberge. En feu qui plus est.
Le jeu se découpe en 3 actes et cest largement suffisant compte tenu des poutres que le gameplay vous collera dans les roues. Car des les premières minutes, vous serez plongés dans lenfer, certes des flammes mais surtout des jeux à base de séquences vidéos. Cet enfer où le mot interactivité rime la plupart du temps avec inanité. Fahrenheit ne fait pas exception à la règle du genre et votre marge décisionnelle sur le jeu se limitera à de timides tapotements erratiques sur les boutons et la croix. Aller à droite/gauche/tout droit, vérifier si une porte est chaude (cette bonne blague), choisir quelle manette coupe le gaz et quelle manette entraîne le processus d'auto-destruction du bâtiment. Le QTE des âges farouches. Des choix qui la plupart du temps entraîneront la cuisson de vos miches à thermostat 9, la mise en scène s'obstinant la plupart du temps à vous saborder le moindre indice visuel qui vous permettrait de savoir quelle décision prendre. « Que se passe-t-il si j'essaye de me servir de l'extincteur ? » Réponse : BOUM. Logique.
Le pinacle de cette épopée étant probablement le deuxième niveau dans lequel notre vaillante troupe de piou-pious jaunes part à la rescousse, que dis-je, la conquête d'une grabataire possédant l'étrange et l'irritant don de se téléporter. Et d'exiger le sauvetage de ses perruches, que dis-je, ses putains de perruches. Ces volatiles représentant plus que la valeur foncière de limmeuble dans lequel vos bourses commencent à cuire dans leur jus. Je passe rapidement sur le jeu des mille portes à ouvrir et les escaliers magiques dans lesquels il faut monter pour aller en bas. Si les flammes ne vous cuisent pas, le level-design s'en chargera.
Le dernier acte n'est ceci dit pas en reste et vaut également son pesant de kérosène avec son scientifique ayant visiblement du mal à gérer une crise de la quarantaine ou à qui on a refusé un budget pour son projet de synthèse de carburant à partir d'opium raffiné, je ne sais plus trop, la narration n'est pas le point fort du jeu. Quoi qu'il en soit, celui-ci décide de passer ses angoisses en menaçant son université de destruction au moyen dune bombe nucléaire, rien de moins. Engin nucléaire que lon désamorcera promptement d'un coup de hache, après de molles déambulations dans des stock-shots de couloirs faisant office de labyrinthe retors. Le contre-terrorisme tient parfois à un bon équipement de base.
Fahrenheit possède cette étrange magie propre aux premiers jeux tentant (en vain) d'exploiter les nouvelles ressources offertes par le support disque, cristallisant alors tous les fantasmes. Impossible de ne pas lui trouver une médiocrité étrangement attachante. Bien sur, seul devant son vis-à-vis cathodique, il n'offre pas le moindre intérêt. C'est sur grand écran, en groupe et avec de la bière à proximité qu'il déploie tout son formidable potentiel. Der Gross Barr de Rïre comme on dit par delà du Rhin. Son postulat ludique d'un autre temps, sa technologie boiteuse et le cabotinage désinhibé de sa brochette d'acteurs nous transportent vers des plaisirs parallèles, stimulant des sens nouveaux et égratignant légèrement notre intégrité de joueurs exigeants. Et, dans un élan où s'entremêlent masochisme, plaisir pervers et soif de découverte, on fait ronfler le lecteur de CD de SEGA, histoire de rappeler que ÇA aussi, il fut un temps, c'était le jeu vidéo. Dans le même état d'esprit qu'une soirée nanar collégiale durant laquelle on programmerait Virus Cannibale de Bruno Mattéï ou un film de Claude Lelouch. Car ce n'est pas parce que c'est mauvais que ça ne peut pas être bon.
PARTY HARD
Le point de vue de César Ramos :
Comme beaucoup (trop ?) de jeux sur ce support, fréquent mais (trop !) cher.
Comme beaucoup (trop ?) de jeux sur ce support, fréquent mais (trop !) cher.